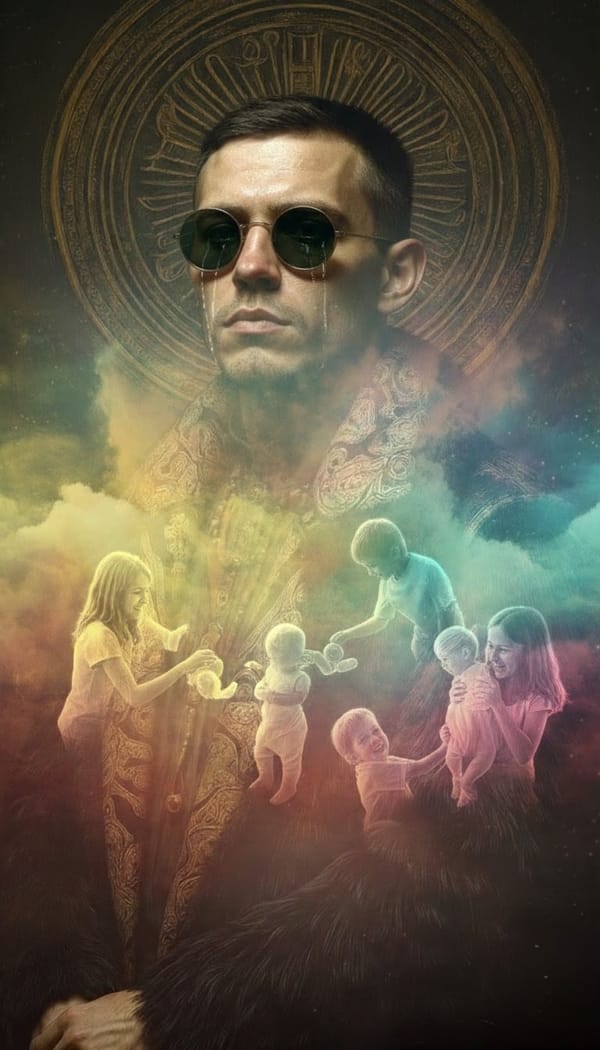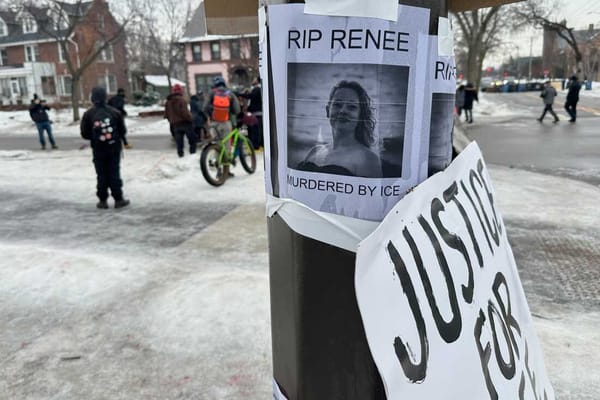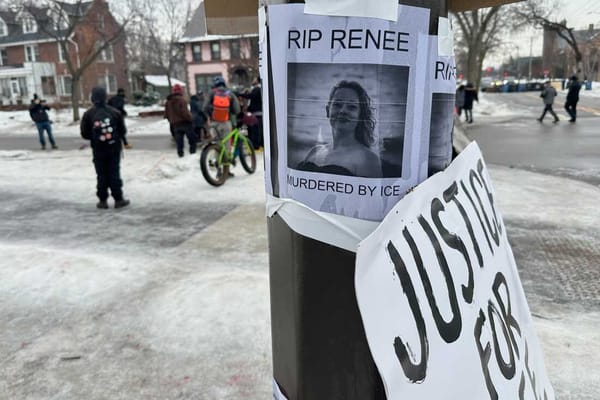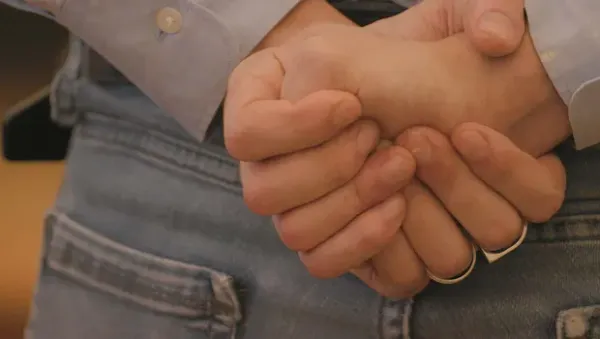Morale et masculinité
Chez Connell, la masculinité hégémonique est un ordre moral valorisant force, contrôle et domination. Être allié, c’est refuser ce cadre, privilégier l’éthique du dialogue et repenser les rapports de genre hors des hiérarchies traditionnelles.

Résumé.
Chez Raewyn Connell, la masculinité hégémonique constitue un ordre moral normatif qui prescrit des valeurs telles que la force, la rationalité, l’autonomie et le contrôle émotionnel. Ces qualités, socialement valorisées, définissent ce qu’est un “homme bien” et légitiment la domination masculine en échange du respect de ce code moral. Cette adhésion repose sur une logique transactionnelle : protéger, travailler, dominer ses émotions, en contrepartie d’un statut supérieur dans l’ordre de genre.
Remettre en question cet ordre, c’est entrer en dissidence et manifester une capacité éthique — une liberté de conscience analogue à ce que Deleuze nomme l’attitude “de gauche”, celle des minorités. La morale, comme le souligne Valérie Rey-Robert, fixe des normes et contrôle les comportements, tandis que l’éthique interroge, dialogue et libère. Dans une perspective antisexiste, la question centrale devient celle de la légitimité et de la portée éthique des rôles genrés.
Être allié, c’est refuser à la fois la domination et la subordination, s’extraire du carcan moral pour réinventer une manière d’être humain avant d’être homme. À l’échelle du couple comme de la société, le bien-être collectif devrait reposer sur la collaboration et non sur la hiérarchie.
Les réactions masculines à la “femme qui demande” (sortir les poubelles, contester, se plaindre) révèlent encore une moralisation du genre, où l’obéissance féminine est érigée en vertu. La “bonne épouse” disparaît dans le silence. Pour dépasser ce schéma, il faut démoraliser la relation de couple : substituer à la tradition une éthique du dialogue et du choix partagé.
Ces deux notions ne sont pas explicitement intriquées chez Raewyn Connell, mais il me semble qu’elle désigne dans "Dés masculinités"[[1]] un lien implicite, une forme de filiation entre les deux. Elles font aussi écho à la dernière newsletter de @valeriereyrobert, que je vous recommande de lire[[2]] si ce n’est pas déjà fait.
Un ordre moral ?
Chez Connell, la masculinité hégémonique est un ordre normatif qui configure l’expression du genre. Cette masculinité prescrit des comportements et des valeurs comme :
la force,
- l’autonomie,
- la rationalité,
- le contrôle émotionnel,
- la compétitivité,
- et l’hétérosexualité.
Ces "qualités" sont considérées comme supérieures dans une société donnée. S’y conformer, c’est appartenir au groupe des hommes et au camp du "bien".
Le consentement
Le consentement actif des hommes à cet ordre moral est nécessaire, car en échange il leur promet — et leur permet — une domination légitimée sur les femmes. Ainsi, pour être un “homme bien”, il faut :
- protéger sa famille,
- travailler dur,
- faire preuve de courage,
- dominer ses émotions.
En retour, on échappe aux groupes de genre dominés et on s’assure de ne pas être en bas de l’échelle.
Dissidence masculine
Remettre en question cet ordre moral, c’est se placer en dissidence. Refuser la législation du genre, c’est rejoindre les masculinités dominées. Mais, critiquer l’ordre moral, c’est aussi se positionner comme individu dans la société et faire la démonstration d’une capacité éthique, d’une liberté de conscience. C’est, d’une certaine manière, être de gauche au sens où l’entend Deleuze dans L’Abécédaire : exister comme minorité[[3]].
Droite-Gauche / Morale-Éthique
Comme l’explique très clairement Valérie Rey-Robert[[1]], le féminisme n’est pas un idéal moral, pas plus que la gauche en général. La morale légifère et contrôle ; l’éthique, elle, interroge et libère. L’éthique suppose un dialogue et une réinvention permanente des règles, alors que la morale fige et établit une norme incontestable. Dans une perspective antisexiste, la vraie question est celle de la légitimité des postures genrées au sein de la société, et de leur portée éthique.
Si on est allié ?
Il me semble qu’être allié, c’est accepter de ne pas appartenir à la masculinité hégémonique, sans pour autant se considérer comme dominé. C’est, par un effort critique, s’extraire du carcan moral de cette masculinité : refuser d’y consentir, mais aussi refuser la subordination à la norme. C’est réinventer une manière d’être humain avant d’être homme, et, comme le dit Deleuze[[3]], penser le monde “en commençant par l'Horizon”, comme étant partie d’un tout.
Faire sa part…
Cela signifie qu’on a bien un rôle à jouer, mais que ce rôle ne découle pas d’une logique abstraite — celle de la morale —, plutôt d’une remédiation, d’un dialogue permanent entre les personnes. La morale fixe une frontière entre le bien et le mal, là où l'éthique permet d'évaluer ce qui est tolérable, à l'échelle locale.
Dans un foyer, les tâches nécessaires au bien-être collectif ne dépendent ni du genre ni de l’âge, mais de la capacité de chacun à contribuer à ce bien-être. À l’échelle sociale, c’est exactement la même logique. Se conformer à une morale patriarcale, c’est considérer que notre bien-être dépend du pouvoir exercé sur autrui. S’en détacher, c’est donner de la liberté aux autres — et en recevoir en retour.
… ou pas ?
Ne pas faire sa part et se ranger du côté des “mecs biens”, c’est adopter une posture transactionnelle dans la relation, qui frôle parfois la pratique mafieuse : la protection et le bien-être matériel en échange de services domestiques et sexuels. C’est aussi confisquer le temps de repos et de loisir des autres pour jouir plus intensément du sien. Une logique à la fois capitaliste et bourgeoise, qui réduit les femmes et les enfants à des individus “mineurs”, tels que les définissait encore le Code napoléonien[[4]] en France.
Le devoir et la responsabilité sont opposés au choix et à la collaboration dans un carcan universaliste. Les individus sont déterminés dans leurs fonctions et leurs actions par leur appartenance à un groupe genré qui s'articule sur une échelle de valeur définie par le masculin.
Sortir les poubelles : épreuve morale ?
Le bon gars.

Cette femme est discréditée à travers le prisme de la masculinité hégémonique :
- Elle n'agit pas en adulte,
- Elle n'est pas autonome,
- Elle est autoritaire,
- Elle manque de courage,
- Elle est mécontante.
Sa demande est déplacée car à la fois elle n'a pas la maturité, l'autonomie, le courage et la maîtrise qu'un homme possède. Elle n'est pas à sa place. Elle est aussi moins efficace que la conjointe de cet homme, qui, elle, fait la démonstration de toutes ces qualités. Qui plus est, la "conjointe" ne conteste pas l'autorité de son époux et ne montre pas son mécontentement. Elle reste, dans son rôle hiérarchique, dans son genre, tout en montrant des qualités féminines.
La question du point de vue[[5]] est ici primordiale. La "bonne épouse" que décrit cet homme n'a pas de qualités masculines. Elle a des qualités qu'un homme recherche chez une bonne épouse. Être adulte, soit, être autonome dans les tâches ménagères. ne pas contester l'autorité, mettre du cœur à l'ouvrage domestique et s'en contenter.
On comprend bien que le dialogue ou la communication au sein du couple ne sont pas de mise, il y a la règle et son application. Chacun fait ce qu'il a à faire de son côté et l'homme sort seulement la poubelle s'il voit qu'il faut le faire. Le point de vue féminin sur la question n'est pas consulté et surtout il est subordonné au regard masculin sur la situation qui est évaluée dans sa portée morale.
Le soutien de famille.

Aimer et obéir sont associés comme le féminisme est implicitement assimilé a une femme désobéissante, mal aimante. Gagner de l'argent donne accès aux services ménagers d'une femme de façon incontestable. Là aussi la question du point de vue est primordiale. La "bonne épouse" ne pense même pas ! Par opposition, la féministe est "endurée" par son homme. Il doit puiser dans sa masculinité pour "tenir".
Le juge.

Faire preuve d'esprit critique, discuter ou manifester son malaise dans le couple, sur les RS, s'octroyer du temps de loisir, de divertissement, de décrochage du quotidien ménager serait un manque d'empathie de la part de son épouse pour un homme qui travaille. Si elle a le temps de se plaindre en commentant des vidéos, c'est qu'elle n'est pas bienveillante envers son homme, qui domine ses émotions.
Encore une fois le regard est discréditant et unilatéral. Si une femme s'autorise la liberté dont cet homme bénéficie et use, elle est moralement condamnable.
La masculinité hégémonique fait des hommes des juges moraux qui évaluent leurs compagnes en fonction de leur capacité à disparaitre dans le silence. Les valeurs morales qui les caractérise sont des crédits qui autorisent l'emprise et légitiment le jugement. Elles structurent un regard qui censure. Moins que l'exécution des tâches ménagères, c'est l'obéissance muette qui est valorisée comme contrefort de la masculinité et du couple.
Celui qui gagne le plus
Dans ces conditions, un homme qui gagnerait moins que son épouse se verrait, moralement, dans ce dispositif, mal à l'aise car illégitime pour exiger silence et obéissance qui sont la base de sa masculinité. C'est un péril ontologique qui induit une crise anomique.
Il est donc primordial de démoraliser la relation de couple en la politisant par le dialogue. Les rôles respectifs doivent être choisis et assumés sur des bases collaboratives choisies et adaptées à la situation des protagonistes, au-delà de considérations morales qui portent à vide ou à charge. Comme l'a montré l'étude Syrda (2019)[[6]], la stabilité et la sérénité d'un couple dépendent de l'établissement des rôles de chacun dans la relation selon un consensus plutôt qu'une tradition.
[[1]]:Connell, Raewyn. 2024[1995]. "Des masculinités. Hégémonie, inégalités, colonialité". Paris: Payot.
[[2]]: V. Rey-Robert, 2025, "La gauche est-elle devenue moraliste ?" https://perdrepieds.kessel.media/
[[3]]: C. Parnet & G. Deleuze, 1988, "G comme Gauche",
L'Abécédaire de Gilles Deleuze, http://palimpsestes.fr/gauche/deleuze_gauche.html
[[4]]: M. Collin, 2015, "Les femmes dominées dans le code Napoléon", La Revue Nouvelle, n° 05, juillet 2015, https://revuenouvelle.be/les-femmes-dominees-dans-le-code-napoleon/
[[5]]: Hartstock, Nancy. 1983. « The Feminist Standpoint, Developing the ground for a specifically feminist historical materialism ». Feminism & Philosophy: 69‑90.
[[6]]: Syrda, J. 2019. “Spousal Relative Income and Male Psychological Distress”. Personality and Social Psychology Bulletin, 46(6), 976-992. https://doi.org/10.1177/0146167219883611